Les réseaux sociaux ont été fort décriés après l’élection de Donald Trump à la présidence américaine. Obama a déploré dans un discours que les faits n’avaient plus d’importance. De leur côté, Le Guardian et quelques autres parlent, depuis le Brexit, d’un monde devenu « post-vérité » (On laissera aux sages et aux philosophes de tout temps et de tous pays le soin de nous dire si ce bas-monde a jamais été un lieu de vérité, car c’est un autre sujet…).
La main sur le cœur, les grands patrons et communicants de la high-tech nous l’ont assuré : ce n’était pas de leur faute, ils n’y étaient pour rien. Pourtant, moins d’une semaine après ces déclarations, les mastodontes de la Silicon Valley annonçaient de nouvelles règles de modération, la suppression de comptes habitués aux propos haineux, etc. Ce n’est peut-être pas seulement parce que la Commission européenne le leur demande depuis le mois de mai, mais bon.
Les premiers à avoir été pointés du doigt furent les algorithmes. Ces types de calculs sont utilisés pour vous proposer systématiquement, sur votre écran bien à vous, des articles qui ressemblent à celui que vous venez de lire. Ce qui a pour effet de vous enfermer dans une bulle, dit-on, où se répète indéfiniment le même type d’opinions. Ce qui, en soi, serait fâcheux mais pas si grave — il nous reste toujours la vraie vie pour échanger nos avis divergents —, si le réseau n’avait pas été submergé de fake news, de fausses nouvelles, dont une majorité semblait aller dans le sens de la campagne trumpienne. Mais qui les a produites, ces fake news ?
Il y avait bien sûr les militants, qui n’ont pas hésité à prendre beaucoup de libertés avec les faits et, notamment, le respect dû aux minorités et aux femmes. C’est d’ailleurs bien ce que l’on reproche au nouvel élu. On soupçonne quelques Russes de s’en être mêlés. Il y a eu aussi des plaisantins. Des petits amuseurs, moins connus que The Onion, Le Gorafi ou El Manchar, dont les blagues ont fait les délices des défenseurs de Trump. Paul Horner, l’un des auteurs de canulars, imaginait naïvement que les démentis ridiculiseraient les militants trop crédules. Il s’avère que c’est lui et ses semblables qui croyaient au père Noël : les fausses nouvelles en circulation ont eu beaucoup plus d’effet que leurs démentis, dont personne ne se préoccupait. La satire et l’ironie sont à manier avec précaution. Beaucoup de précautions.
Enfin, et ça mérite quelque attention, on trouve ce qu’on appelle les fermes à clics. Des gens y sont payés pour gonfler l’audience d’un article ou d’une vidéo. Mieux, on peut y acheter la fabrication de textes et d’images. Le sociologue Antonio Casilli rappelle ainsi que l’on a retrouvé l’auteure d’un slide-show pro-Trump : c’était une collégienne Singapourienne de 15 ans. Elle n’avait aucune idée de qui était Donald Trump. Elle a été recrutée par la plateforme Fiverr, spécialisée dans ce genre d’embauche de « travailleurs indépendants ». Ces micro-travailleurs résident dans plus de 200 pays, principalement en Asie du Sud-est, en Afrique du Sud, en Amérique latine, en Inde ou en Europe orientale.
Donc, oui, Donald Trump, qui s’est fait élire en promettant de rapatrier le travail dans son pays, a, en fait, acheté ses fans numériques… hors des USA. Dont 60 % des « amis » de sa page Facebook. Il s’inscrit ainsi dans une logique étudiée par l’Oxford Internet Institute : les pays du Sud deviennent les producteurs de micro-tâches pour les pays du Nord. Il s’agit d’un véritable marché du travail au rabais : UpWork compte 10 millions d’utilisateurs, Freelancers.com, 18 millions.
Alors, ces sites ne servent pas qu’à cela, mais cette histoire nous montre comment les extrêmes droites du Nord font leur succès en exploitant les pauvres du Sud. Les réseaux sociaux et leurs algorithmes n’y sont pas pour grand-chose, en effet. Ou plus exactement, ils ne sont rien d’autre que les outils d’un rapport de force qui se tient, depuis longtemps, loin du clavier. Rien de bien nouveau sous le soleil. Et le candidat de la droite française nous expliquera peut-être qu’il s’agit pour lui de la continuation de ce qu’il appelle un simple « partage de cultures », somme toute.
En 1982, un autre Donald, Fagen celui-là, et qui savait manier l’ironie, étonnait le monde musical avec l’album The Nighfly, où il revisitait à sa manière le rêve américain des années ’50.
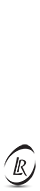
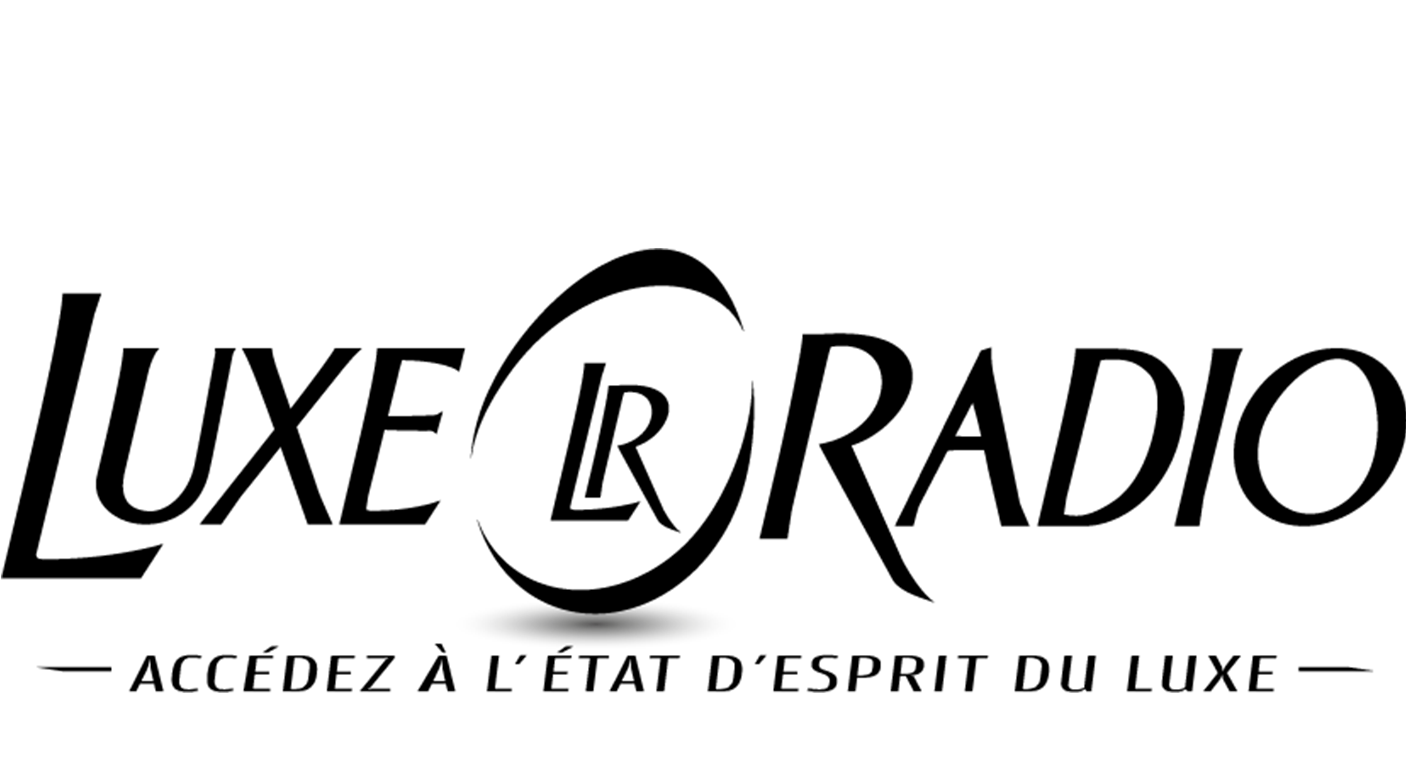


 Éloge de l’impur
Éloge de l’impur Cri d’alarme des scientifiques : « repenser une civilisation où l’Homme est responsable de la nature »
Cri d’alarme des scientifiques : « repenser une civilisation où l’Homme est responsable de la nature » Sur internet, la liberté d’expression ou la liberté d’impression psychologique ?
Sur internet, la liberté d’expression ou la liberté d’impression psychologique ? Vente d’esclaves en Libye : « vieux réflexe de l’archaïsme violent » selon Driss Jaydane
Vente d’esclaves en Libye : « vieux réflexe de l’archaïsme violent » selon Driss Jaydane
Poster un Commentaire