Dans Le Monde du 1er juillet, Maïa Mazaurette revient sur la question de la pédophilie, en France. Elle a l’immense mérite de faire une histoire des idées, et de la perception publique de ces actes, en s’abstenant de jugement moral anachronique. Entendons-nous bien : elle est, bien évidemment, horrifiée par de telles pratiques. Mais elle commence par rappeler qu’en 1977, Le Monde, précisément, publiait une tribune en défense de trois hommes poursuivis pour des rapports avec des mineurs-es de 13 et 14 ans.
Rédigé par Gabriel Matzneff, le texte était cosigné par rien moins que Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Gilles Deleuze, Roland Barthes, Patrice Chéreau, Félix Guattari, Michel Leiris, Philippe Sollers, André Glucksmann, Jack Lang, Bernard Kouchner et Louis Aragon… Cela « ressemblait au Bottin mondain », note la journaliste. À l’extrême droite comme très à gauche, se voulant « aristocratique » ou « émancipatrice » selon les cas, il y a la croyance que ces relations pouvaient « libérer l’enfant du joug familial ».
Il faudra les années 80 et les témoignages de victimes pour que leur souffrance devienne, enfin, la notion centrale, tandis qu’apparaît le mot « pédophilie », et les années 90 pour que la condamnation se fasse unanime. Avec l’affaire Dutroux, de très sinistre mémoire, c’est désormais une pathologie.
L’on peut ainsi mesurer avec acuité l’évolution des mentalités, dans une même société, en « seulement » 20 ans. La morale, donc, n’est ni figée, ni une valeur identitaire anhistorique. Par ailleurs, un magistrat rappelle qu’il faut grandement se méfier du stéréotype du « monstre pervers ». « La majorité des violences sur enfant, souligne-t-il, se passent en secret dans la sphère familiale. » (Ce qui est aussi vrai des violences faites aux femmes, soit dit en passant.)
En conclusion, l’article cite Sophia Leventidi, qui s’inquiète de ce que « dans le même temps où se lève une réprobation sans précédent contre les pédophiles, on voit partout une enfance sexualisée ». La mode et la publicité étalent sur les écrans — qui s’allument aussi chez nous — une enfance à la fois sacrée et érotisée, ce qui n’est pas pour la rassurer.
Plusieurs explications peuvent venir à l’idée. L’être humain est ainsi fait que, plus c’est interdit, plus la transgression lui fait envie. Trop ériger un tabou en limite ultime, c’est prendre le risque de construire un fantasme. Les pays les plus « conservateurs » sont les plus consommateurs de pornographie, et ce n’est pas un hasard. Voilà un sujet où la juste mesure est difficile à trouver, en effet.
On peut observer aussi que les sociétés rurales placent, toutes, à la puberté l’âge déterminant, qui recule au même rythme qu’avancent l’urbanisation et l’espérance de vie — en Europe, en Inde, en Amérique Latine ou au Maghreb… Mais, outre que cela n’excuse rien, cela ne nous dit pas tout non plus.
C’est une caractéristique des sociétés modernes — ou post-… — que de ne plus percevoir l’innocence que sous les traits de l’enfance. Il y a là, peut-être, un héritage du puritanisme du XIXe siècle, et de son violent contrôle des corps par la société de discipline. Car confondre la notion d’innocence, donc de sacré, avec l’ignorance de la sexualité, cela suppose, avant, de considérer l’amour comme forcément coupable. Ce qui n’a pas toujours été le cas, loin de là.
Or, par définition, l’innocence est éminemment désirable. Mais l’innocence des adultes. L’innocence d’une relation amoureuse est très différente de l’ignorance puérile. Un enfant naît dans la fitra, dit-on. Et si le jeune adulte en est sorti, c’est qu’il a appris à distinguer le bien et le mal, notamment parmi ses pulsions et ses affects. Seulement, tous les sages nous enjoignent, ensuite, de retrouver cette fitra. Mais il s’agit alors, pourra-t-on dire, d’une « innocence seconde », qui n’oblitère pas la discrimination des obligations sociales, à commencer par le respect d’autrui.
Cette recherche d’une « innocence seconde » peut nourrir l’érotisme adulte, si elle n’en est pas la source même. Mais la notion perdue de vue, apparaissent le puritanisme et sa confusion entre innocence et ignorance. Une indistinction spectaculaire qui n’a plus que la figure de l’enfance pour signifier l’innocence, le sacré et le désirable.
Don Raye et Gene de Paul ont écrit en 1941 un morceau qui est devenu un standard. Sur son album Walkin’, de 1954, Miles Davis, accompagné entre autres d’Horace Silver au piano et de Kenny Klark à la batterie, enregistrait à son tour une version de You don’t know what love is.
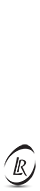
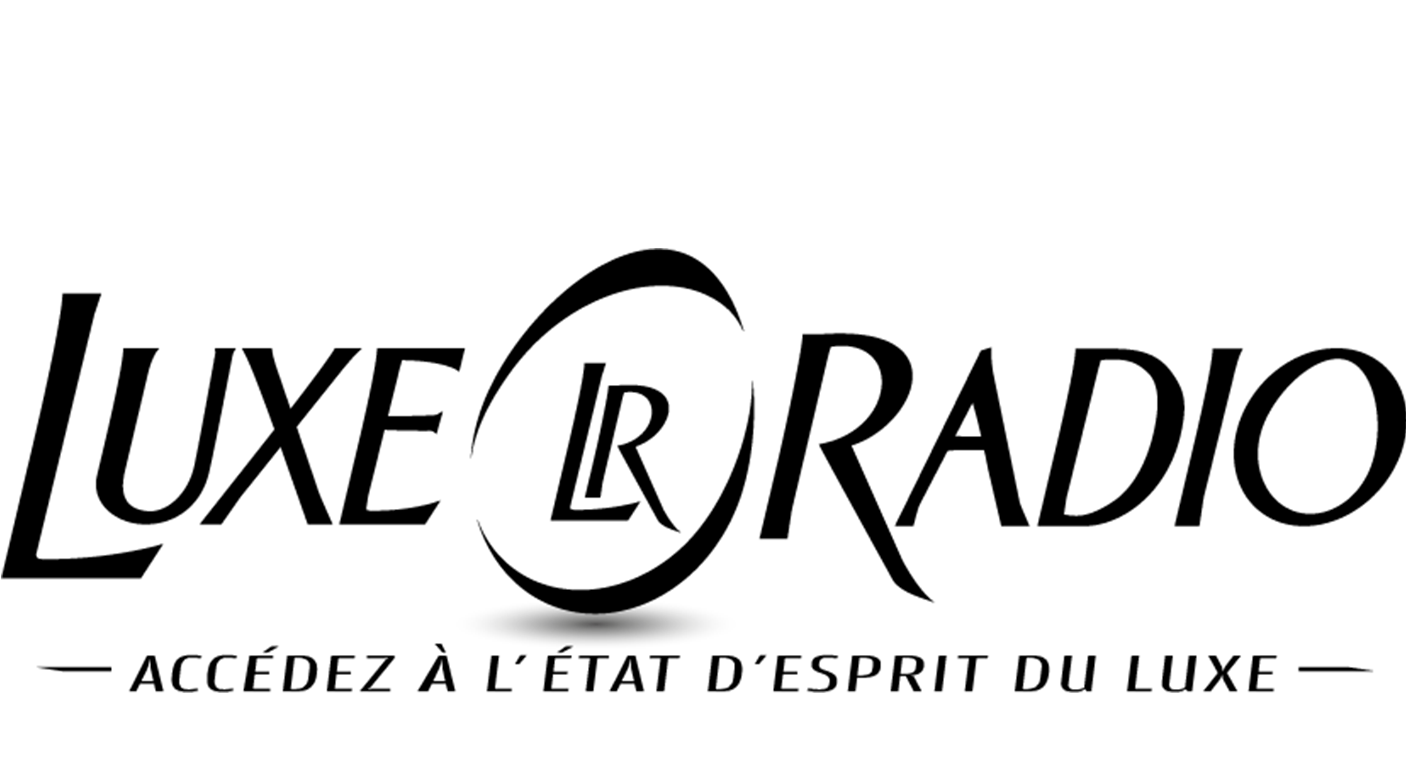


 Éloge de l’impur
Éloge de l’impur Cri d’alarme des scientifiques : « repenser une civilisation où l’Homme est responsable de la nature »
Cri d’alarme des scientifiques : « repenser une civilisation où l’Homme est responsable de la nature » Sur internet, la liberté d’expression ou la liberté d’impression psychologique ?
Sur internet, la liberté d’expression ou la liberté d’impression psychologique ? Vente d’esclaves en Libye : « vieux réflexe de l’archaïsme violent » selon Driss Jaydane
Vente d’esclaves en Libye : « vieux réflexe de l’archaïsme violent » selon Driss Jaydane
Poster un Commentaire