Il est peu courant que ce soit aussi rapide. Les trois grandes agences américaines de renseignement (FBI, CIA, NSA) ont rendu public leur rapport conjoint sur les « influences » russes qui ont visé la campagne électorale de 2016. Daté de janvier 2017, le document est diffusé par le Washington Post depuis vendredi 23 juin. On peut y lire l’hyperpuissance disséquer ce qu’elle-même a souvent pratiqué, à différentes échelles, sur toute la planète. Bien sûr, le texte est expurgé.
Les espions, comme les journalistes, tiennent à protéger leurs sources. Les hommes de l’ombre précisent aussi que leur travail n’est pas d’analyser les effets sur l’opinion publique ou le résultat des élections. Ils se concentrent sur la réalité des activités russes, ou pro-russes, tendant à influencer la vie politique américaine. Les auteurs font enfin une mention discrète de l’amélioration de leurs « standards » de travail depuis « une dizaine d’années ». Un lecteur taquin pourrait comprendre qu’une mise à niveau des méthodes était nécessaire après les retentissants échecs de 2001 et 2003. Mais bon.
Sur le fond, le rapport n’est pas fracassant. En l’absence inévitable des sources, il consiste surtout en un rappel de faits et d’affirmations déjà connus. Mais ainsi rassemblés et commentés sous un jour précis, la tentative ne fait plus de doute. Le locataire de la Maison-Blanche, qui, quelques jours avant, traitait toujours cette histoire de « Dem hoax », de « canular démocrate », n’a pu retenir un tweet rageur contre… son prédécesseur. Oui, Donald Trump vient d’accuser Barack Obama, vendredi soir, de ne pas avoir fait assez pour empêcher ce que lui, Trump, disait ne pas exister. C’est sans doute une tentative de contre-feu de sa part, mais elle ne lui donne pas l’air très intelligent, encore une fois.
Pour l’aspect cybernétique de l’offensive russe, le rapport pointe avec « high confidence » — le mot clef bureaucratique pour « des informations de haute qualité, recoupées par plusieurs sources » — le renseignement militaire russe. Désigné par son vieil acronyme GRU, il serait à la manœuvre derrière différents groupes de hackers identifiés qui, eux, n’ont évidemment aucun lien officiel avec l’État russe.
Cloisonnement et coupe-circuits sont une règle de base en espionnage. C’est autant pour les rêves naïvement libertaires qui animaient les premiers pirates des années 90 : l’ancienne génération du cyber voit ses activités, qu’elle croyait émancipatrices, passer sous les drapeaux des généraux — de tous pays. De son côté, Wikileaks est ici plus présentée comme instrumentalisée qu’accusée de collusion, même si l’embauche de Julian Assange par la chaîne de télé Russia Today est rappelée.
Le volet médiatique est plus transparent. Il n’est qu’à se souvenir du sinistre faux, les Protocoles des sages de Sion, forgé par un policier du Tsar, ou de la longue pratique du stalinisme et de la Pravda sous Brejnev pour mesurer combien le savoir-faire des services russes, qui tiennent toujours le pays, est une expérience séculaire. Nos agents américains ont l’air de s’étonner de ce que RT America, version locale de Russia Today, obtienne, sur YouTube, de meilleurs scores qu’Al Jazeera english et CNN. Moscou a consacré 190 millions de dollars à sa diffusion, notent-ils, et ses journalistes ont systématiquement critiqué Hillary Clinton et loué le candidat Trump.
Incidemment, ils relèvent aussi que la couverture du mouvement Occupy Wall Street, en 2011, avait été plus que favorable aux contestataires — pourtant à l’exact opposé d’un Donald Trump. Le rapport n’attaque nullement Occupy lui-même, mais expose une tentative d’utilisation, par une puissance étrangère, d’un évènement purement intérieur. Les auteurs décortiquent une stratégie qui consiste à souffler sur les braises de la colère et attiser le ressentiment dans un pays cible. On peut comprendre leur inquiétude, puisque le Kremlin dispose clairement d’un peu plus de moyens qu’un aventureux propriétaire de coffee shops néerlandais. Mais, là-bas comme ici, la défense la plus efficace est encore de réduire les sources de mécontentement. À la base.
L’irlandais David Holmes publie en 1997 son deuxième album, Let’s get killed, où il continue d’afficher sa passion pour la musique de cinéma — qui le lui rendra bien, puisque Hollywood le repère au même moment. Cette année-là, il se contente encore de films imaginaires, et de revisiter, brillamment, le thème de James Bond dans Radio 7.
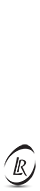
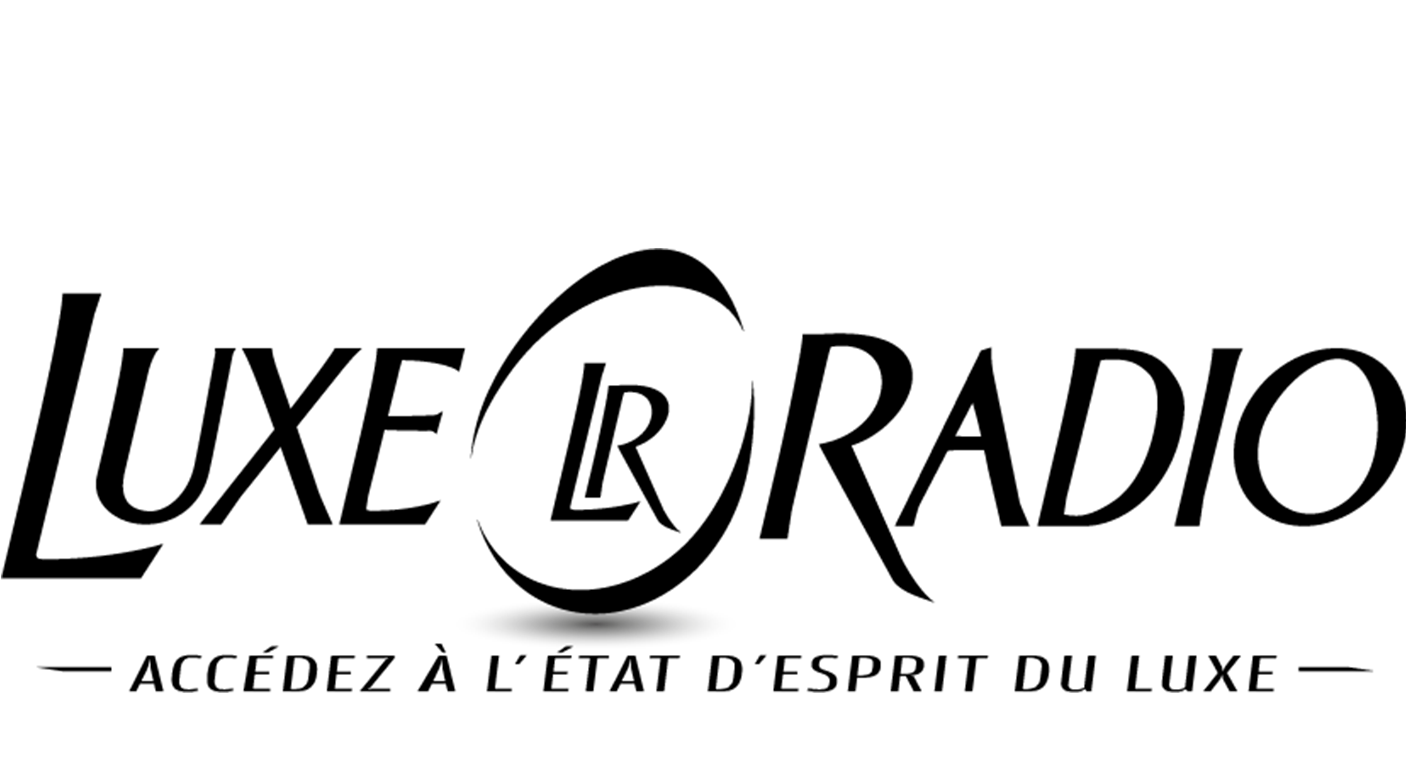


 Éloge de l’impur
Éloge de l’impur Cri d’alarme des scientifiques : « repenser une civilisation où l’Homme est responsable de la nature »
Cri d’alarme des scientifiques : « repenser une civilisation où l’Homme est responsable de la nature » Sur internet, la liberté d’expression ou la liberté d’impression psychologique ?
Sur internet, la liberté d’expression ou la liberté d’impression psychologique ? Vente d’esclaves en Libye : « vieux réflexe de l’archaïsme violent » selon Driss Jaydane
Vente d’esclaves en Libye : « vieux réflexe de l’archaïsme violent » selon Driss Jaydane
Poster un Commentaire