La dette souveraine marocaine est-elle soutenable ? La question n’arrête pas d’être soulever ici et là, dans les médias, dans la presse écrite, sur les forums, et même dans les cafés, tout le monde s’improvise « expert en macroéconomie ».
Mais qu’en est-il réellement ? Est-ce réellement une problématique purement économique ? Cette dette est-elle réellement souveraine ? Est-elle réellement la notre ? Et surtout, comment en est-on arrivé là ? Trop de questions pour une poignée de minutes.
Cependant, j’aimerais m’ attarder sur un point qui me parait souvent négligé par les faux prophètes de l’économie libérale, celui de la reconfiguration de la souveraineté nationale par la logique de la dette.
Alors, tout commence avec la privatisation de la Monnaie.
En plus d’être un instrument d’échange comme tout un chacun le sait, la monnaie est avant tout un bien public, puisqu’elle fait partie des droits régaliens de l’Etat, en l’occurrence celui de battre monnaie.
Elle est également une croyance collective, dans la mesure où sa valeur nominale, c’est-à-dire celle écrite sur le billet, dépasse largement sa valeur intrinsèque, celle du papier sur lequel cette valeur est imprimée.
Par conséquent, la valeur d’un billet est une valeur contractuelle entre nous et l’émetteur, qui est normalement l’Etat.
Or, le Maroc, s’est inscrit bon gré mal gré dans une logique de privatisation de la monnaie entamée durant les 1970 en Europe, en accordant l’indépendance aux Banques Centrales. L’idée était d’empêcher les gouvernements de recourir systématiquement à la planche à billets pour se financer, car cela augmentait l’endettement et nourrissait l’inflation, ou en d’autres termes la montée des prix.
En effet, à partir de 2006, le statut de Bank Al Maghrib, notre Banque Centrale, lui interdit de prêter directement à l’Etat. Or avant, l’Etat pouvait, par le biais de la Banque Centrale se prêter à lui-même à taux zéro ou à des taux très favorables pour entre autres investir dans l’économie réelle à travers de grands projets publics (barrages, chemin de fer, infrastructures,…).
Mais comme le besoin de financement public est structurel dans des pays en voie de développement comme le Maroc, et comme l’Etat ne peut plus se prêter à lui-même, il se voit obligé d’emprunter sur les marchés à des taux élevés. On commence par le marché national, puis quand cela ne suffit plus, l’Etat s’endette sur le marché international, et c’est là la « boite de Pandore » qu’il ne faut surtout pas ouvrir.
On combat le feu avec de l’essence!
Dans ce schéma, l’Etat n’a plus le droit de créer de la monnaie par la dette et par le déficit budgétaire, donc seuls les banques privées et plus globalement les marchés financiers peuvent le faire. Cette privatisation de la monnaie visait donc au final à neutraliser le pouvoir régalien de l’Etat, c’est-à-dire le nôtre, de créer de l’argent, et d’échapper à la dette non souveraine, c’est-à-dire à la dette extérieure.
Les marchés financiers ont ainsi enclenché avec la bénédiction et l’aide du FMI, un transfert de la « souveraineté monétaire » de l’Etat vers les marchés financiers internationaux.
Une fois endetté à l’internationale, cette dette extérieure est structurellement irremboursable, pour la bonne et simple raison qu’elle est libellée en devises étrangères (dollar et euro), que notre balance commerciale est structurellement déficitaire et que notre PIB (Produit Intérieur Brut) est produit en Dirham. Donc la calculer en pourcentage du PIB est une aberration.
Et comme si cela ne suffisait pas, on nous demande également de transférer la détermination de la valeur de notre monnaie nationale, le dirham, aux marchés financiers internationaux, en nous demandant de passer à un régime de taux de change flottant. Et quelle a été la réponse de nos politiques? Et bien comme d’habitude on s’est plié devant le FMI en acceptant et en courbant l’échine.
C’est-à-dire que notre pouvoir d’achat sera bientôt déterminé par des gens qui spéculeront sur notre dirham à la City de Londres.
La logique de l’endettement de l’Etat est par bien des aspects similaires à celle des individus et des ménages, puisqu’elle vise entre autres à réduire ce que Frédéric Lordon appelle « l’angle Alpha ».
L’angle Alpha désigne très métaphoriquement l’écart entre mon désir en tant que salarié (celui de faire du théâtre, de passer plus de temps avec ma famille, de voir mes enfants grandir, de voyager…et ce genre de choses) et le désir maître, celui du détenteur du capital, le patron, les actionnaires, et dont l’unique désir est de le faire fructifier au maximum, notamment en cherchant à aligner mon désir au sien.
Cela passe par tout un mécanisme d’aliénation qui aboutit à des réflexions du genre :
- Mon travail est toute ma vie !
Ou encore :
- C’est dingue, je suis accro à mon travail !
C’est la force d’enrôlement et d’aliénation du capitalisme.
Or comme l’idéologie libérale a progressivement réduit la « liberté » au « désir », et le « désir » à l’ « acte d’achat », à un certain stade le salaire ne suffit plus, et c’est là où intervient le crédit de consommation, ou en d’autres termes « l’endettement », qui vient renforcer la force aliénatoire du rapport salarial au capital. Car pour honorer sa dette, il faut avant tout ne pas perdre son travail. Ainsi, l’alignement du désir et de la puissance d’agir des salariés avec celle du capital devient parfaite, et il n’y a plus d’angle alpha, plus de résistance trigonométrique, plus de devenir orthogonale dirait Frédéric Lordon.
Le libéralisme a ainsi organisé la dépendance à l’argent sous une configuration très particulière, dont la finalité est une forme de servitude volontaire, aussi bien des individus que des Etats.
Voltaire aurait probablement dit : « que chacun cultive son angle alpha ».
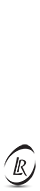
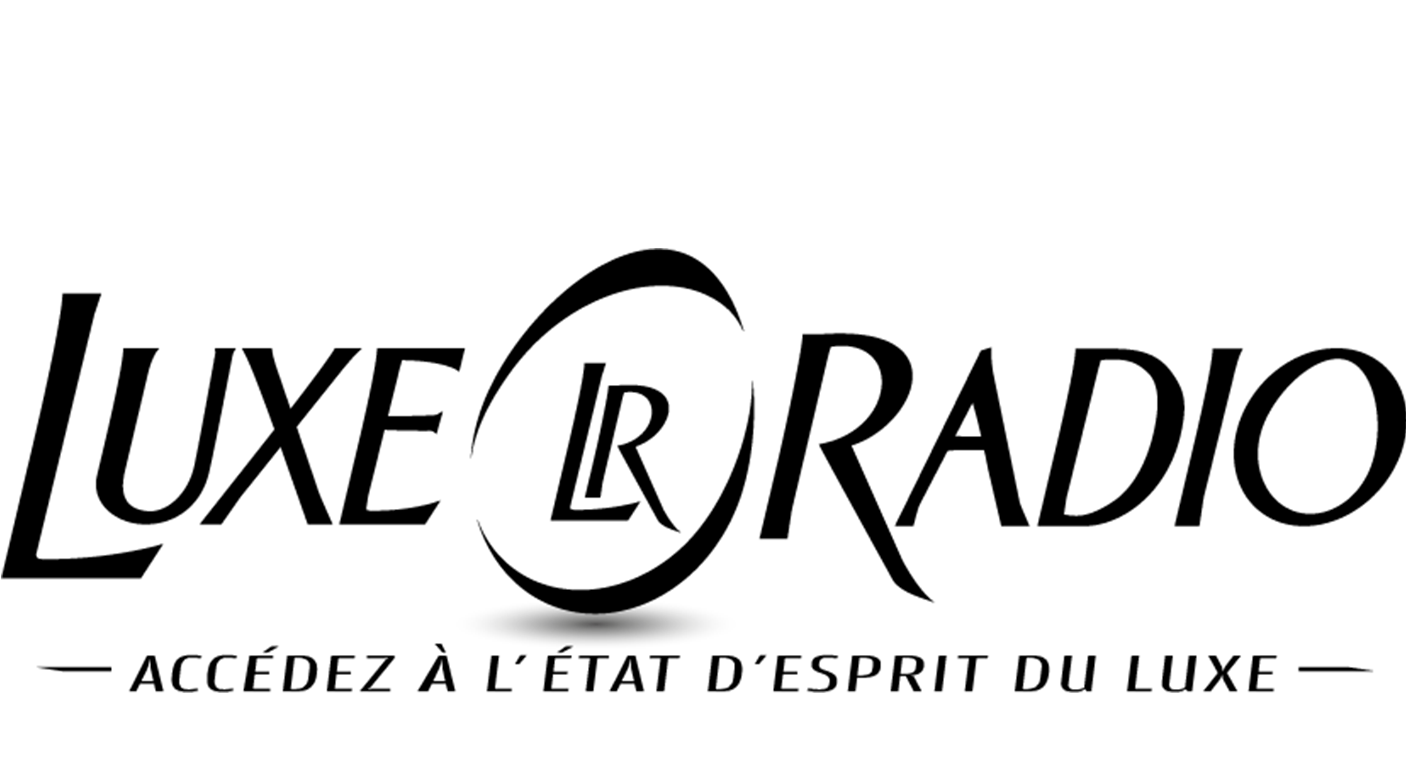


 Éloge de l’impur
Éloge de l’impur Cri d’alarme des scientifiques : « repenser une civilisation où l’Homme est responsable de la nature »
Cri d’alarme des scientifiques : « repenser une civilisation où l’Homme est responsable de la nature » Sur internet, la liberté d’expression ou la liberté d’impression psychologique ?
Sur internet, la liberté d’expression ou la liberté d’impression psychologique ? Vente d’esclaves en Libye : « vieux réflexe de l’archaïsme violent » selon Driss Jaydane
Vente d’esclaves en Libye : « vieux réflexe de l’archaïsme violent » selon Driss Jaydane
Poster un Commentaire