« Bleu d’acier et légères, agitées par un imperceptible vent debout, les vagues de l’Adriatique avaient déferlé à la rencontre de l’escadre impériale lorsque celle-ci, ayant à sa gauche les collines aplaties de la côte de Calabre qui se rapprochaient peu à peu, cinglait vers le ports de Brindisium, et maintenant que la solitude ensoleillée… »
Voilà, tout commence sur les flots, et tout est dit…
Répétons ces deux mots… Solitude, Ensoleillée…
De quoi s’agit-il, au fond, ici ?
D’abord, l’extrait que je viens de vous lire, est tiré de La Mort de Virgile, de Hermann Broch, il y raconte comment Virgile, l’auteur de l’Enéide, revient mourir en Grèce, le grand Virgile, déçu par son temps, qui au cours de ses derniers jours, voulu détruire le manuscrit de ce qui reste l’une des plus belles œuvres jamais écrites…
Hermann Broch, né à Vienne, d’une famille bourgeoise, et donc voué à l’industrie, et qui, lors d’un voyage aux Etats-Unis, abandonne les études qui doivent faire de lui un homme d’affaires… Pour les mathématiques, et la philosophie…
Solitude ensoleillée d’un choix, d’une vie, d’une sorte d’implacable destin qui tombe sur la tête d’un homme qui, abandonne les machines, les usines, pour entrer dans l’univers mystérieux, terrible à sa manière, des grandes machineries littéraires, historiques…
Hermann Broch qui, dans un livre qui s’intitule, ou plutôt qui s’appelle… Les Irresponsables, qui en porte le nom, et le porte jusqu’à nous, – dit peut-être ce que nous savons déjà, mais qu’il faut relire, redire, – car s’il est une fonction souvent oubliée des livres, de ces grands textes, c’est que la puissance de véridiction qu’il renferme, a le pouvoir étrange, implacable, et presque intolérable au fond, de nous forcer à l’oubli…Puissance voulant que, s’ils s’écrivent en un temps, et en un lieu c’est probablement à tous les temps, et à tous les lieux qu’ils sont destinés.
Les Irresponsables, donc, – Allemagne des années 30,petits personnages que leurs petites vies, leurs petits métiers, leurs petits vestibules, leurs ridicules chapeaux, portemanteaux, que leurs soupes trop lourdes, indigestes, visqueuses, mangées salement, – Les Irresponsables, ce roman de la médiocrité satisfaite, écrit comme s’énonce une maladie qui s’annonce, d’abord, par la poussée sur un corps, de simples petits furoncles, sécrétions minimes, ces accumulations de petites haines, de petites misères, ces somatisations qui s’ajoutent les unes aux autres, pour atteindre au corps social d’un peuple prêt à défiler au pas de loi…
Les Irresponsables, – montée du nazisme en quelques histoires simples, – quand l’Histoire complote avec le quotidien, derrière lequel elle se cache et compte jusqu’à 38, 39, 40, pour se mettre à chercher ses victimes…
À révéler sa rage, trop longtemps feutrée, mais que seuls les grands livres, les grands écrivains, – les voyants, savent décrire, avant, après, – car voir, ici, ce n’est pas deviner… Ce n’est pas l’avoir dit avant les autres, – ça, c’est la pathologie de notre temps ! – non, écrire, c’est dire où se cache, où se cachaient déjà le Mal, c’est trouver le monstre…
C’est montrer le lieu où le trésor, le coffre qui contient, soit les pierres précieuses de l’âge d’or ou les perles de sang de l’âge de haine, – oui, écrire, c’est faire l’anatomie de l’âme d’un peuple, à un moment, – et si l’on sait regarder assez profondément, dans ce corps, ce cœur ouvert, on peut alors sentir battre le cœur palpitant du Monde, palpitant de mots, et de vérité… Vérité voulant que celle qui fût, et que celle qui vient, sont à la fois, et tour à tour l’aînée et la cadette… Que ces deux-là, bien que par des siècles séparés peuvent se vérifier jumelles…
Solitude ensoleillée des grands livres dont l’éclat, s’il vient de quelque lieu, provient des profondeurs de l’Enfer, du courage de cheminer, seul, le long d’un couloir obscur, de la force d’aller à la rencontre des créatures de la nuit, – celles de l’époque, celles des Hommes de son temps, celles des siens,…
Alors, ne peut-on penser que cette médiocrité satisfaite, dont se délectent les nouvelles haines ordinaires et les racismes de bon aloi, que ces images qui tractent des morts qu’elles ne montrent pas, et surtout, que cette juxtaposition savante et quotidienne de crimes et de frime calcine le temps, ne peut-on appeler au secours la solitude ensoleillée d’un grand livre, d’une œuvre qui serait, pour parler comme Kafka, comme une hache brisant la mer gelée en nous… La mer, l’eau pure et agitée, ou l’océan d’acier, – oui, c’est là peut-être le seul espoir, sur lequel flotte, peut-être, quelque part, le manuscrit de l’immense poème que son auteur, agonisant, veut peut-être jeter au feu, mais qui ne brûlera pas…
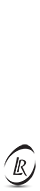
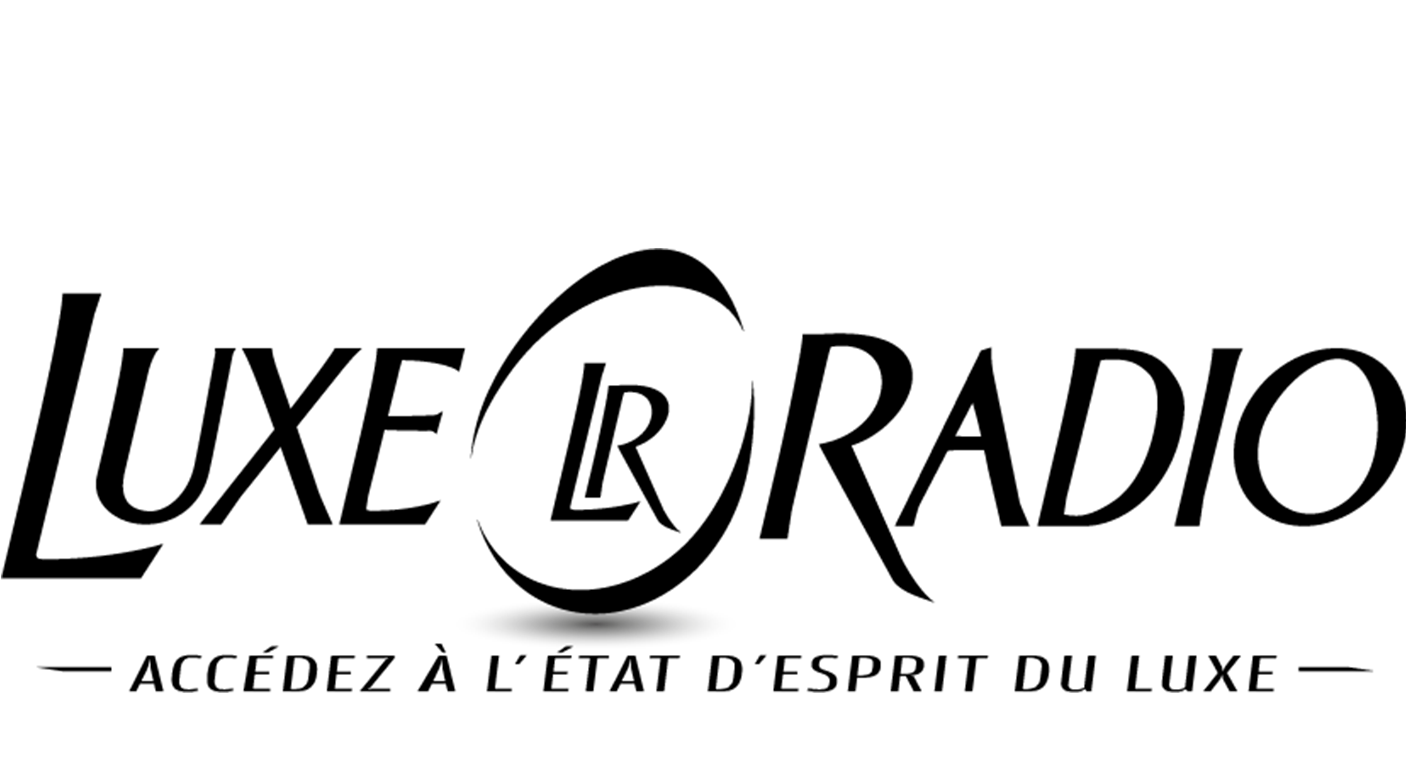


 Éloge de l’impur
Éloge de l’impur Cri d’alarme des scientifiques : « repenser une civilisation où l’Homme est responsable de la nature »
Cri d’alarme des scientifiques : « repenser une civilisation où l’Homme est responsable de la nature » Sur internet, la liberté d’expression ou la liberté d’impression psychologique ?
Sur internet, la liberté d’expression ou la liberté d’impression psychologique ? Vente d’esclaves en Libye : « vieux réflexe de l’archaïsme violent » selon Driss Jaydane
Vente d’esclaves en Libye : « vieux réflexe de l’archaïsme violent » selon Driss Jaydane
Poster un Commentaire