« L’Amérique n’est pas innocente », c’est sur cette idée, mise en exergue du premier roman, en 1995, que James Ellroy a composé sa trilogie Underworld USA. L’éditeur de la traduction française a cru bon de changer les titres, mais dans un anglais plus « international », en globish, quoi. Ainsi, le troisième volume s’intitule Underworld USA (comme la trilogie) plutôt que Blood’s a Rover, littéralement : « Le sang est un vagabond ». Ce titre original est tiré d’un poème d’Alfred Housman, placé en tête du roman, dont le premier vers est : « L’argile reste immobile, mais le sang est un vagabond » ou « court sur la terre ». En anglais, de rover à river, rivière, il n’y a qu’une assonance.
Ellroy en avait assez d’entendre, de lire, de voir les années Kennedy présentées comme l’âge d’or d’une supposée innocence étatsunienne. Il a donc patiemment construit une fresque historique, romanesque en diable et documentée comme un rapport policier. Les faits — célèbres — sont là. Leur interprétation, en revanche, jouit de toute la licence de la fiction. L’auteur, qui se revendique conservateur, nous plonge dans les méandres d’une droite américaine d’abord en lutte avec elle-même. J. Edgar Hoover est à cette saga ce que Darth Vador était aux premières trilogies de Star Wars : le véritable héros, mais anti.
Son obsession anti-communiste le conduit, au fil des pages, à envoyer ses hommes infiltrer et instrumentaliser mafiosi, clan Kennedy (lié aux premiers), Howard Hughes, Klu Klux Klan, anticastristes, dealers d’héroïne et bien d’autres encore. Ces chantages, extorsions et assassinats, ont comme victimes, après JFK et Martin Luther King, les Afro-Américains. Ellroy nous conte finalement leur lutte d’émancipation à travers les yeux de leurs oppresseurs. Il faut aimer frémir en tournant les pages pour le lire.
Le maître du roman noir n’oublie pas les femmes. Peu nombreuses chez ces puissants — comme dans la vraie vie —, elles comptent. Le personnage de Janice est la première figure, aussi forte qu’ambivalente. À la fin du premier livre, elle demande le divorce à son riche klansmen et maître chanteur de mari, qui lui laisse le choix entre partir sans un sou ou recevoir un coup de club de golf pour bénéficier de ses droits. Dans le second volume, elle boîte jusqu’à sa mort.
Le troisième met en scène une universitaire de Berkeley — la génération combative, après la résistante — ainsi qu’une mystérieuse aventurière communiste, passée par l’Algérie en guerre décoloniale. Elle y aurait vendu de l’héroïne pour financer ses activités, tout comme nos voyous de droite en ont importé depuis Saïgon pour pouvoir payer leurs coups de main contre Cuba. Ellroy suggère les liens internationaux. Son tueur mercenaire manipulé par la CIA est un Français, que, malicieux, il a affublé du nom d’un critique littéraire toulousain et bienveillant à son endroit : Mesplède.
La Guerre froide constitue l’arrière-plan historique, mais le lecteur ne trouve dans ces pages que la description clinique et factuelle des actes d’hommes enfermés dans leur logique paranoïaque. Au fil du récit, ils dysfonctionnent de plus en plus sévèrement, par abus de substances chimiques et par trop de culpabilité, peut-on deviner. Nous sommes chez un auteur américain, clairement, qui nous rappelle à l’effroyable violence autour de la fracture raciale qui structure, somme toute, la société américaine.
L’on peut donc comprendre l’émoi des survivants de ces décennies lorsque la direction de Facebook a présenté, le 14 octobre, au groupe de parlementaires Noirs, son rapport sur les 100 000 $ de publicités payées sur son site par la société russe Internet Research Agency, ou IRA, et ses nombreux comptes. Rien de neuf, au fond, comme le rappelle The Atlantic. Dès les années 20, la propagande du Komintern instrumentalisait les injustices américaines pour ses besoins. Si la Guerre froide fut un haut moment de ces activités, son retour est à l’évidence voulu par Moscou, sans doute pour appuyer ses prétentions sur l’Ukraine.
Le mensuel expose comment des militants Noirs trop naïfs ont été poussés à s’entraîner et à s’armer par des trolls de l’IRA. De son côté, le Washington Post du 17 octobre raconte comment la même compagnie pétersbourgeoise a administré une page « Heart of Texas », qui appelait à la sécession de l’État. Avec cette page, ils ont organisé, en mai dernier, une manifestation de suprémacistes Blancs, pas plus malins que d’habitude. Armés de fusils semi-automatiques AR-15 et portant des T-shirts « White Lives Matter », ils se sont réunis devant une mosquée de Houston, aux cris de « Stop à l’islamisation du Texas » (sic). Ils déclaraient se sentir « menacés par l’influx de l’islam » (re-sic) aux États-Unis.
Les représentants communautaires Noirs ou musulmans font remarquer que la meilleure contre-offensive serait bien sûr de réduire le gouffre raciste qui divise leur pays. En attendant, la Russie n’est pas plus innocente que l’Amérique, et mérite le même regard critique.
En 1981, dans l’Allemagne coupée en deux par le Mur de Berlin, le groupe Trio publiait un morceau de new wave post-punk minimaliste. Succès international, il captait l’air du temps désabusé de la décennie qui s’ouvrait, Da, da, da.
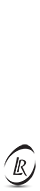
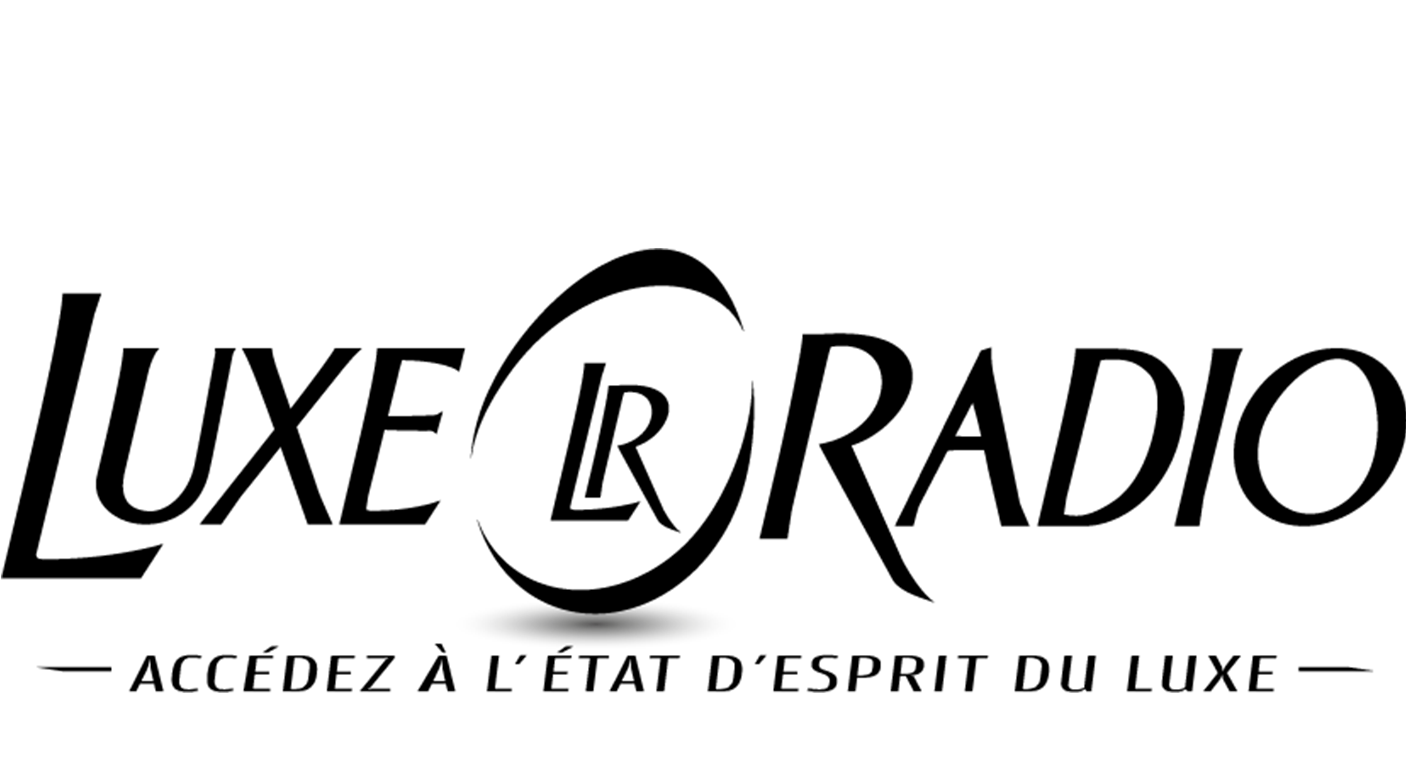


 Éloge de l’impur
Éloge de l’impur Cri d’alarme des scientifiques : « repenser une civilisation où l’Homme est responsable de la nature »
Cri d’alarme des scientifiques : « repenser une civilisation où l’Homme est responsable de la nature » Sur internet, la liberté d’expression ou la liberté d’impression psychologique ?
Sur internet, la liberté d’expression ou la liberté d’impression psychologique ? Vente d’esclaves en Libye : « vieux réflexe de l’archaïsme violent » selon Driss Jaydane
Vente d’esclaves en Libye : « vieux réflexe de l’archaïsme violent » selon Driss Jaydane
Poster un Commentaire