Et ce matin, suite au débat de la semaine dernière où Redouan, plus Bisounours que moi, pour une fois, se demandait pourquoi les médias ne traitent pas de certains sujets pourtant importants ou sensibles, je vais tenter d’y apporter une réponse de technicienne. La première chose que l’on apprend en école de journalisme, c’est à respecter la loi de proximité.
C’est très humain : ce qui se passe près de chez nous, qui concerne peut-être même des gens qu’on connaît, nous concerne plus que ce qui a lieu loin, très loin. Et bien sûr, cette loi de proximité n’est pas que géographique, elle se décline aussi en termes temporels : ce qu’il se passe aujourd’hui intéresse plus que ce qu’il s’est passé il y a quelques temps. Et ce qui concerne nos centres d’intérêt est plus pertinent que ce qui a rapport à un domaine qui ne nous touche pas, forcément. C’est ce que l’on appelle la loi de proximité, ou, plus cyniquement, loi du mort-kilomètre, selon une expression consacrée par une expérience sociale menée en 2000 démontrant que les personnes habitant loin ( » eux « ) nous apparaissent moins humains que « nous ». Ce phénomène décrit par le sociologue américain Leyes est appelé infrahumanisation.
Alors oui, en plus, il y a un deuxième effet Kiss Cool, les journalistes, on leur a toujours dit que le must du must, c’était de faire du terrain. Ce qui veut dire qu’il vaut mieux parler d’un truc sur lequel on aurait pu enquêter. Bon, après, la réalité du métier, l’obligation de produire des articles à la volée fait que c’est rarement le cas. Mais enfin, les chaînes d’info en continue, par exemple, sont pleines de reportages passionnants de terrain sur les intempéries où l’on demande aux automobilistes visiblement bloqués par la neige si c’est bien la neige qui les bloque.
Plus sérieusement, le résultat est là et bien là. Nous sommes face à un paradoxe terrible : nous avons de plus en plus de médias et de moins en moins d’info diversifiée. Ainsi, Alisa Miller, la directrice de Public Radio International (l’un des plus grands réseaux médias américains), faisait remarquer dès 2008 lors d’une conférence TED que si plus de la moitié des américains déclarent vouloir suivre les informations internationales, la majeure partie des grands médias ne dispose plus de correspondants et couvrir Britney Spears coûte moins cher. En février 2007, la mort d’Anna Nicole Smith a ainsi été dix fois plus traitée par les télévisions américaines que le rapport du GIEC mettant en cause l’activité humaine dans le réchauffement climatique, pourtant délivré ce même mois. Et, continuait-elle, une étude sur les médias Online prouvait qu’Internet ne faisait pas mieux, recyclant essentiellement des dépêches d’agences telles que Reuters ou bien Associated Press. Sur les 14 000 articles parus sur la page d’accueil de Google News durant toute l’année 2007, expliquait-elle encore, seuls 24 événements avaient été traités.
Et bien entendu, ce ne sont pas les stars de l’info system, qu’il s’agisse de peoples ou bien de ces quelques experts qui se partagent le paysage médiatique finalement restreint qui s’en plaindront. Mais tout de même : est-ce que la seule loi de proximité permet d’expliquer cette pauvreté dans l’info traitée ? Non, bien entendu. En réalité, une autre dimension, que j’ai évoqué en passant un peu plus tôt est au coeur de la problématique : le pognon. Tout le monde vous le dira, l’information est en crise, les médias, pas rentables, bref. Le journaliste coûte cher et rapporte peu. Alors, il faut rationnaliser les coûts, c’est-à-dire sabrer dans les moyens de production d’infos, les journalistes. Tandis qu’à une époque, on envisageait facilement de payer un journaliste pour creuser un sujet parfois des mois durant, désormais, il s’agit de faire du volume d’information à la chaîne le plus rapidement possible. Et plus les médias sont, dits d’information générale, comme une chaîne d’information en continue, par exemple, plus l’enjeu est conséquent. On ne traite donc plus d’information internationale lourde, sauf en cas d’événement particulier, car payer un correspondant n’est pas rentable par rapport à la production qu’on peut en attendre pouvant satisfaire à un public donné. Idem pour les localiers, réduits à la portion congrue, voire disparaissant corps et biens. Les analystes s’invitent au coup par coup car dans un monde technocratique, il les faut spécialistes et on n’en a pas l’usage tous les jours. Les reporters sont limités dans leurs déplacements, ils ne sont pas très qualifiés, souvent jeunes et leur qualité principale est d’être sans opinion marquée, inodores et incolores, bref parfaitement interchangeables et peu coûteux – on appelle cela être objectif. Pour le reste, on mise sur un groupe souvent réduit de journalistes, dits de desk, c’est-à-dire travaillant en bureau à partir d’éléments recueillis par les agences de presse et enrobant comme ils le peuvent, les reportages « exclusifs » de leurs collègues faisant le poireau à 10 kilomètres d’une usine « tout à fait similaire à celle dans laquelle s’est retranché le terroriste, mais la police fait barrage, donc on ne peut pas voir grand-chose, pour le moment. »
Et pourtant, c’est bien dommage, tant l’image fournie par la télé, le son, à la radio et puis la rapidité, via le Web, permet au monde entier de s’enflammer pour quelque chose de lointain qui, tout d’un coup, nous touche en plein coeur. Alors pourquoi ne pas tenir compte de cela pour créer de l’info ? On le fait, ne vous inquiétez pas : en particulier, ceux qui, pour des raisons politiques, voudraient nous vendre des guerres auxquelles à la base nous n’avons aucune envie de participer. C’est la fameuse fabrique du consentement, d’abord théorisé par le journaliste et essayiste politique Walter Lippman et dont, par la suite le sociologue Noam Chomsky a fait l’ensemble de sa carrière.
Alors quelle conséquence pour le public ? Elle est terrible : de véritables zones blanches d’information, qui pourraient pourtant être pertinentes et même essentielles se créent, parce que « ça n’intéresse pas notre cible » ou bien c’est trop coûteux à traiter. La solution ? Revenir à une vision plus juste de ce que peut ou ne peut pas faire le journalisme. Ou, comme le dit le sociologue Patrick Charaudeau, il faut une « Condition de « modestie » d’abord. […] La vision du monde sociale que proposent les médias est à la fois trop fragmentaire et obsessionnelle. Condition de « courage » ensuite. Les médias doivent accepter de reconnaître que la cible à laquelle ils s’adressent est une inconnue, difficile à maîtriser, dont on ne peut prédire les réactions pulsionnelles ni même rationnelles. » Et j’ajouterais : condition d’honnêteté intellectuelle et d’engagement personnel : savoir qu’on ne peut pas être objectif, qu’on est forcément, pour le pire et le meilleur, humains, rien qu’humains. Et qu’on fait de notre mieux.
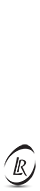
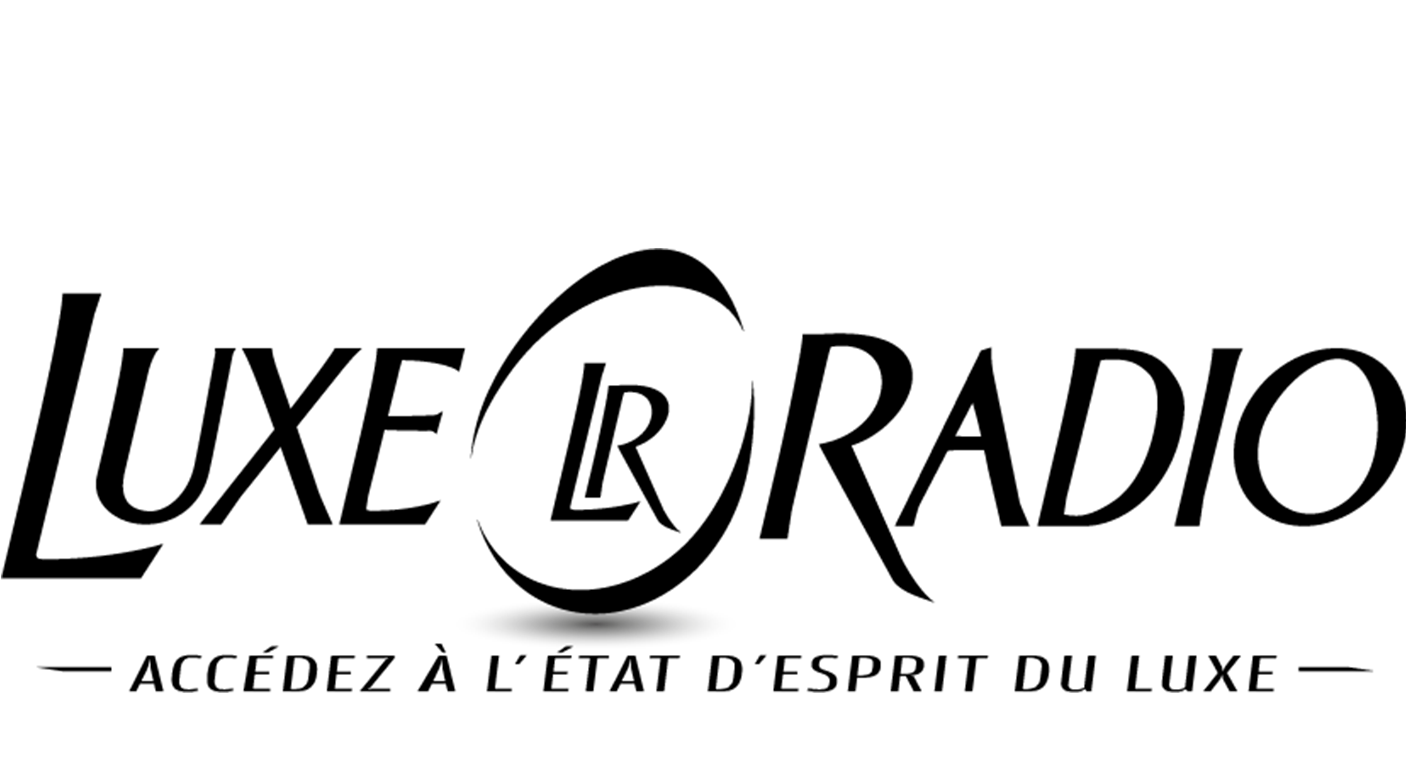


 Éloge de l’impur
Éloge de l’impur Cri d’alarme des scientifiques : « repenser une civilisation où l’Homme est responsable de la nature »
Cri d’alarme des scientifiques : « repenser une civilisation où l’Homme est responsable de la nature » Sur internet, la liberté d’expression ou la liberté d’impression psychologique ?
Sur internet, la liberté d’expression ou la liberté d’impression psychologique ? Vente d’esclaves en Libye : « vieux réflexe de l’archaïsme violent » selon Driss Jaydane
Vente d’esclaves en Libye : « vieux réflexe de l’archaïsme violent » selon Driss Jaydane
Poster un Commentaire